Rentrée littéraire : 4…3…2…1… Partez !
En 2016, comme chaque année, il y a foule sur la ligne de départ. Après beaucoup de discussions et quelques disputes, « Marianne » a choisi 10 romans réjouissants, épatants ou glaçants. Soutenez avec nous la sélection française !
Les athlètes français n’étaient pas tous à Rio : comme la littérature est une épreuve d’endurance et d’adresse, beaucoup d’écrivains se sont échauffés ces derniers mois, relisant à la plage ou à la campagne les épreuves de leurs livres, corrigeant çà et là une phrase maladroite, appelant leur éditeur ou leur attaché de presse en plein milieu de la nuit.
Tous craignaient de ne pas être prêts pour la rentrée littéraire, qui débute très exactement le 18 août dans les librairies. Ils sont nombreux cette année : 363 écrivains français sont dans les starting-blocks, chacun espérant sortir du lot – et peut-être, obtenir un prix cet automne ! La rédaction de Marianne a plongé tout l’été dans ce torrent de pages, pour vous présenter les dix romans les plus enthousiasmants de cette rentrée 2016.
Laurent Nunez
► 4 récits pour comprendre notre époque
Le monde entier dans un roman
L’insousciance, de Karine Tuil, Gallimard, 530p., 22€.
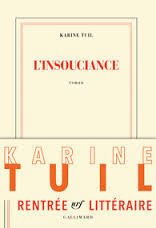 C’est le roman de toutes les blessures contemporaines, la fresque de notre société divisée, l’épopée d’une décennie française d’après le 11 septembre 2001, celle des engagements militaires au Proche-Orient et des montées aux extrêmes, du discours républicain qui fout le camp face aux clivages raciaux et aux cités abandonnées. Là où Michel Houellebecq peignait une France travaillée par ses fantasmes identitaires avec aigreur et mélancolie, Karine Tuil montre l’Histoire en marche et les classes sociales en guerre. Roman choral écrit au scalpel, à la surface des discours et des représentations, l’Insouciance attrape ainsi le destin enchevêtré par le désir de personnages types de leur époque, du soldat traumatisé au patron d’affaires déboussolé ; sans complaisance avec l’ambition des dominants ni avec la rancœur des dominés, épinglant aussi bien les communautarismes que l’effroyable difficulté à vouloir échapper à ses origines, renvoyant dos à dos racisme et bien-pensance, démontant la machine à broyer les êtres qu’est la politique autant que la puissance destructrice des passions privées, en montrant sans jamais juger, la romancière donne une peinture âpre, puissante, impitoyable d’un moment historique de basculement et de vies devenues sans repères. «Mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde», rappelle Karine Tuil en citant Albert Camus. Savoir enfin les nommer, dans leur cruauté même, c’est nous donner l’occasion de les penser.
C’est le roman de toutes les blessures contemporaines, la fresque de notre société divisée, l’épopée d’une décennie française d’après le 11 septembre 2001, celle des engagements militaires au Proche-Orient et des montées aux extrêmes, du discours républicain qui fout le camp face aux clivages raciaux et aux cités abandonnées. Là où Michel Houellebecq peignait une France travaillée par ses fantasmes identitaires avec aigreur et mélancolie, Karine Tuil montre l’Histoire en marche et les classes sociales en guerre. Roman choral écrit au scalpel, à la surface des discours et des représentations, l’Insouciance attrape ainsi le destin enchevêtré par le désir de personnages types de leur époque, du soldat traumatisé au patron d’affaires déboussolé ; sans complaisance avec l’ambition des dominants ni avec la rancœur des dominés, épinglant aussi bien les communautarismes que l’effroyable difficulté à vouloir échapper à ses origines, renvoyant dos à dos racisme et bien-pensance, démontant la machine à broyer les êtres qu’est la politique autant que la puissance destructrice des passions privées, en montrant sans jamais juger, la romancière donne une peinture âpre, puissante, impitoyable d’un moment historique de basculement et de vies devenues sans repères. «Mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde», rappelle Karine Tuil en citant Albert Camus. Savoir enfin les nommer, dans leur cruauté même, c’est nous donner l’occasion de les penser.
Alexandre Gefen
Sans famille
L’absente, de Lionel Duroy, Julliard, 360p., 19,50€.
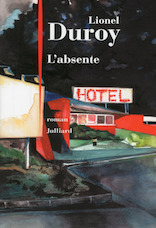 Il en faut du souffle pour suivre les pérégrinations d’Augustin dans l’Absente. Car lui en a à revendre, comme jamais. Reprenant le personnage de son précédant roman, Echapper, Lionel Duroy poursuit dans cette nouvelle autofiction l’introspection de son histoire, tel un archéologue, grattant sans fin les accidents de sa vie. Après son divorce, Augustin, écrivain, doit se séparer de sa maison, dernier rempart de ses certitudes. Il fourgue objets et souvenirs sauvés du déménagement dans sa voiture, deux vélos sur le toit, et file sur les routes. Partir, vite, avaler les kilomètres non pas pour fuir, mais à la recherche du temps perdu que l’événement fait résonner : l’expulsion dans le passé de sa famille et la déchéance dans laquelle sa mère a alors basculé. Eternel torturé, Lionel Duroy n’en finit pas d’explorer le puits sans fond de sa blessure originelle, de cette mère indigne (il n’est jamais question de «ma mère», mais de «la mère»). Mais celle qui fut l’«ouragan», l’«idiote», la «cinglée» ou la «fielleuse» dans ses précédents romans trouve ici quelque grâce à ses yeux, ou du moins une certaine indulgence. Il s’agit cette fois de trouver une raison à ce désamour ravageur, de percer le secret des photos de famille, de traquer la vérité. Alerte, brillante et furieuse, la plume de Duroy nous embarque dans la tourmente, généreuse pour livrer l’émotion de l’instant, le détail de la situation, toujours à l’affût de la vie des autres.
Il en faut du souffle pour suivre les pérégrinations d’Augustin dans l’Absente. Car lui en a à revendre, comme jamais. Reprenant le personnage de son précédant roman, Echapper, Lionel Duroy poursuit dans cette nouvelle autofiction l’introspection de son histoire, tel un archéologue, grattant sans fin les accidents de sa vie. Après son divorce, Augustin, écrivain, doit se séparer de sa maison, dernier rempart de ses certitudes. Il fourgue objets et souvenirs sauvés du déménagement dans sa voiture, deux vélos sur le toit, et file sur les routes. Partir, vite, avaler les kilomètres non pas pour fuir, mais à la recherche du temps perdu que l’événement fait résonner : l’expulsion dans le passé de sa famille et la déchéance dans laquelle sa mère a alors basculé. Eternel torturé, Lionel Duroy n’en finit pas d’explorer le puits sans fond de sa blessure originelle, de cette mère indigne (il n’est jamais question de «ma mère», mais de «la mère»). Mais celle qui fut l’«ouragan», l’«idiote», la «cinglée» ou la «fielleuse» dans ses précédents romans trouve ici quelque grâce à ses yeux, ou du moins une certaine indulgence. Il s’agit cette fois de trouver une raison à ce désamour ravageur, de percer le secret des photos de famille, de traquer la vérité. Alerte, brillante et furieuse, la plume de Duroy nous embarque dans la tourmente, généreuse pour livrer l’émotion de l’instant, le détail de la situation, toujours à l’affût de la vie des autres.
Frédérique Briard
Tout va trop vite
A tombeau ouvert, de Bernard Chambaz, Stock, 207 p., 18 €.
C’est l’histoire d’un héros silencieux, triste et beau. Mort en pleine gloire, au moment où il s’y attendait le plus. C’était le 1er mai 1994, un accident d’une rare violence et un moment suspendu qui semblait ne jamais devoir finir. Ayrton Senna, idole de toute la nation brésilienne, venait de sortir de la piste d’Imola et de percuter un mur à 260 km/h. Ce jour-là, Bernard Chambaz regardait la télévision d’un œil distrait. Sans le son. De toutes façons, les commentateurs s’étaient tus, pétrifiés et conscients de l’inexorable tragédie en train de se jouer sous les yeux de millions de téléspectateurs. Deux ans plus tôt, Bernard Chambaz avait perdu un de ses fils, Martin. Les deux garçons se ressemblaient.
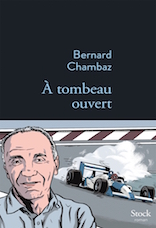 La course automobile est vue par ceux qu’elle fascine comme une bataille de dieux païens, leur quête de la vitesse comme un défi ordalique, une maîtrise presque absolue d’où le risque ultime ne peut pas être aboli, livré à la puissance capricieuse du hasard. A tombeau ouvert, c’est un Panthéon de pilotes qui se regardent les uns les autres, s’admirent et se mesurent, des mortels avec leurs plaisirs, leurs bonheurs et leurs angoisses. Fangio, De Cesaris, Lauda, Ratzenberger, des vies toujours en suspens, marquées par le drame même quand elles y échappent. Bernard Chambaz tourne autour de sa propre douleur, d’une blessure impossible à refermer, construisant livre après livre le mausolée de son enfant, lui créant et se créant des compagnons d’au-delà. Il fait de Senna, mystique simple et tourmenté, le frère en miroir de Martin. C’est digne, poignant, une manière élégante de se tenir toujours debout, aux côtés de ceux qui sont déjà partis, en veillant sur les vivants.
La course automobile est vue par ceux qu’elle fascine comme une bataille de dieux païens, leur quête de la vitesse comme un défi ordalique, une maîtrise presque absolue d’où le risque ultime ne peut pas être aboli, livré à la puissance capricieuse du hasard. A tombeau ouvert, c’est un Panthéon de pilotes qui se regardent les uns les autres, s’admirent et se mesurent, des mortels avec leurs plaisirs, leurs bonheurs et leurs angoisses. Fangio, De Cesaris, Lauda, Ratzenberger, des vies toujours en suspens, marquées par le drame même quand elles y échappent. Bernard Chambaz tourne autour de sa propre douleur, d’une blessure impossible à refermer, construisant livre après livre le mausolée de son enfant, lui créant et se créant des compagnons d’au-delà. Il fait de Senna, mystique simple et tourmenté, le frère en miroir de Martin. C’est digne, poignant, une manière élégante de se tenir toujours debout, aux côtés de ceux qui sont déjà partis, en veillant sur les vivants.
Hubert Prolongeau
Le bonheur est dans la crise
Repose-toi sur moi, de Serge Joncour, Flammarion, 431 p., 21 €.
 C’est beau, c’est rusé, c’est costaud. C’est Joncour, qui pour son onzième roman claque un titre plein d’amour et de malice. Et dès la première scène, on est convaincu du bon sens en action chez l’auteur. Depuis deux ans qu’il vit à Paris, Ludovic est recouvreur de dettes, un emploi qui va comme un gant à ce campagnard discret qui a pourtant quelques comptes à régler avec son passé. En face, dans la cour de son immeuble, il y a Aurore, styliste confrontée aux commandes annulées, aux coups fourrés de son associé, et à son mari trop absent qui va devenir trop présent. Aurore et Ludovic mettront bien du temps à se croiser, à se rencontrer, et finalement à coïncider : Joncour fait en sorte que ce soit inévitable, indiscutable, tout en restant surprenant. Les deux protagonistes pourraient accaparer le titre de cette histoire, laquelle est une histoire d’amour où vient se loger la question… de la dette. Celle des ménages, celles d’un pays, celle de l’Europe, ou même la nôtre quand le destin vient présenter une note qu’on pensait enterrée. Jouant subtilement sur les microcosmes et les macrocosmes, l’auteur décline ces dettes, ces crises, ces échappatoires, et dessine des tangentes de courage et de liberté. Au croisement de la fiction sociologique, du roman d’amour et de la tragi-comédie, Repose-toi sur moi est le roman vrai, puissant, frais et léger, sur la France en crise(s).
C’est beau, c’est rusé, c’est costaud. C’est Joncour, qui pour son onzième roman claque un titre plein d’amour et de malice. Et dès la première scène, on est convaincu du bon sens en action chez l’auteur. Depuis deux ans qu’il vit à Paris, Ludovic est recouvreur de dettes, un emploi qui va comme un gant à ce campagnard discret qui a pourtant quelques comptes à régler avec son passé. En face, dans la cour de son immeuble, il y a Aurore, styliste confrontée aux commandes annulées, aux coups fourrés de son associé, et à son mari trop absent qui va devenir trop présent. Aurore et Ludovic mettront bien du temps à se croiser, à se rencontrer, et finalement à coïncider : Joncour fait en sorte que ce soit inévitable, indiscutable, tout en restant surprenant. Les deux protagonistes pourraient accaparer le titre de cette histoire, laquelle est une histoire d’amour où vient se loger la question… de la dette. Celle des ménages, celles d’un pays, celle de l’Europe, ou même la nôtre quand le destin vient présenter une note qu’on pensait enterrée. Jouant subtilement sur les microcosmes et les macrocosmes, l’auteur décline ces dettes, ces crises, ces échappatoires, et dessine des tangentes de courage et de liberté. Au croisement de la fiction sociologique, du roman d’amour et de la tragi-comédie, Repose-toi sur moi est le roman vrai, puissant, frais et léger, sur la France en crise(s).
Hubert Artus
► 3 histoires pour changer sa vie
Entrer dans la vie adulte?
La Succession, de Jean-Paul Dubois, L’Olivier, 234 p., 19 €.
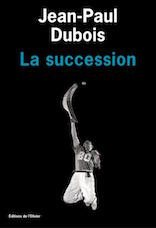 Cela fait déjà quelque temps que l’on entre dans chaque nouveau roman de Jean-Paul Dubois comme on pénétrerait dans une maison familière. Le mobilier n’a pas changé, tout est en place, mais – bien heureusement – les drames qui se jouent dans ces pièces figées se renouvellent à chaque fois. Comme un inventaire de routine, la Succession redéploie donc toutes les marottes du romancier : un personnage principal nommé Paul, le deuil comme point de départ, un père mystérieux, Toulouse et les Etats-Unis (plus précisément, la Floride), des vieilles voitures, un chien sauvé des eaux, etc. «La succession» du titre, voilà la grande affaire de Jean-Paul Dubois : l’enchaînement et la continuité – la constance de ses œuvres, formant toujours des réceptacles recueillant les mêmes motifs que leur prédécesseur. C’est tout naturellement donc que le nouveau roman du Toulousain raconte l’histoire d’un héritage : Paul Katrakilis, fils unique d’une famille de suicidés, apprend le décès de son père et doit choisir entre poursuivre son rêve d’enfance (être joueur professionnel de pelote basque) ou rentrer au bercail pour reprendre le cabinet de médecin familial. Tout en ressassements et incessants retours, la narration spiralée de Jean-Paul Dubois avance – paradoxalement – par petites répétitions qui fonctionnent comme des coups de marteau enfonçant le clou de la mélancolie. Après tout, la vie et l’écriture auraient beaucoup à voir avec la pratique de la pelote basque : «des gestes simples cent fois répétés».
Cela fait déjà quelque temps que l’on entre dans chaque nouveau roman de Jean-Paul Dubois comme on pénétrerait dans une maison familière. Le mobilier n’a pas changé, tout est en place, mais – bien heureusement – les drames qui se jouent dans ces pièces figées se renouvellent à chaque fois. Comme un inventaire de routine, la Succession redéploie donc toutes les marottes du romancier : un personnage principal nommé Paul, le deuil comme point de départ, un père mystérieux, Toulouse et les Etats-Unis (plus précisément, la Floride), des vieilles voitures, un chien sauvé des eaux, etc. «La succession» du titre, voilà la grande affaire de Jean-Paul Dubois : l’enchaînement et la continuité – la constance de ses œuvres, formant toujours des réceptacles recueillant les mêmes motifs que leur prédécesseur. C’est tout naturellement donc que le nouveau roman du Toulousain raconte l’histoire d’un héritage : Paul Katrakilis, fils unique d’une famille de suicidés, apprend le décès de son père et doit choisir entre poursuivre son rêve d’enfance (être joueur professionnel de pelote basque) ou rentrer au bercail pour reprendre le cabinet de médecin familial. Tout en ressassements et incessants retours, la narration spiralée de Jean-Paul Dubois avance – paradoxalement – par petites répétitions qui fonctionnent comme des coups de marteau enfonçant le clou de la mélancolie. Après tout, la vie et l’écriture auraient beaucoup à voir avec la pratique de la pelote basque : «des gestes simples cent fois répétés».
Pierre-Edouard Peillon
Loin des autres, mais près de soi
Le Grand Jeu, de Céline Minard, Rivages, 192 p., 20 €.
 Certains font le grand saut, d’autres font le grand vide autour d’eux et en eux : il s’agit de «désadhérer», comme l’écrit la narratrice du Grand Jeu. Alors elle se proclame propriétaire d’un bout de massif montagneux, et s’installe dans ce refuge qu’elle avait entièrement conçu et dessiné, dans l’objectif de vivre ici pour l’éternité. Marches, escalade, jardinage, méditation : elle s’épuise pour mieux se défier, et rédige un journal de bord qui devient un manuel de savoir-vivre avec les éléments, la nature et le vivant. Le roman est entièrement constitué de ce journal. Mais voilà que tout bascule : une cabane non loin de là semble habitée. C’est un roman-miroir cérébral et naturaliste, qui réfléchit sur la place de l’individu dans le temps, dans le monde, et la modernité. Un livre court et mystérieux, qui répond autant au précédent roman de l’auteur (Faillir être flingué), un western à grand vent, qu’à celui qui l’a fait connaître (le Dernier Monde), une science-fiction bien tapée. Dans l’œuvre singulière et obsédante que compose Céline Minard, chaque roman est un grand contre-pied où elle joue avec le lecteur, avec ses personnages, avec l’espace et avec elle-même, s’appliquant cette phrase énoncée par son ermite : «Comment pourrait-il accueillir le monde celui qui ne se mise pas lui-même ?» Tout ça est plein d’envergure et de sens.
Certains font le grand saut, d’autres font le grand vide autour d’eux et en eux : il s’agit de «désadhérer», comme l’écrit la narratrice du Grand Jeu. Alors elle se proclame propriétaire d’un bout de massif montagneux, et s’installe dans ce refuge qu’elle avait entièrement conçu et dessiné, dans l’objectif de vivre ici pour l’éternité. Marches, escalade, jardinage, méditation : elle s’épuise pour mieux se défier, et rédige un journal de bord qui devient un manuel de savoir-vivre avec les éléments, la nature et le vivant. Le roman est entièrement constitué de ce journal. Mais voilà que tout bascule : une cabane non loin de là semble habitée. C’est un roman-miroir cérébral et naturaliste, qui réfléchit sur la place de l’individu dans le temps, dans le monde, et la modernité. Un livre court et mystérieux, qui répond autant au précédent roman de l’auteur (Faillir être flingué), un western à grand vent, qu’à celui qui l’a fait connaître (le Dernier Monde), une science-fiction bien tapée. Dans l’œuvre singulière et obsédante que compose Céline Minard, chaque roman est un grand contre-pied où elle joue avec le lecteur, avec ses personnages, avec l’espace et avec elle-même, s’appliquant cette phrase énoncée par son ermite : «Comment pourrait-il accueillir le monde celui qui ne se mise pas lui-même ?» Tout ça est plein d’envergure et de sens.
Hubert Artus
Le vert paradis des amours enfantines
Les Yeux noirs, de Frédéric Boyer, POL, 208 p., 15 €.
 Parce qu’il a donné rendez-vous, en lui, à l’enfant qu’il a été, le narrateur se bat en duel avec ses souvenirs, ces «prisonniers repentis». Mais le passé est un «aspirateur à matière» – un trou noir -, et la mémoire un «château des erreurs». Comment, dès lors, renouer avec une sensation perdue ? A Nice, dans le jardin d’enfants des sœurs du Saint-Esprit, il frappait trois coups à la porte du dortoir, puis deux. Un code secret qui lui donnait accès à «l’une des chambres les plus secrètes de [s]a mémoire» : deux yeux noirs magnifiques l’attendaient, et de grandes jupes évasées qui frôlaient l’enfant de cinq ans. De la nudité, des caresses de cette jeune fille vite dissoute dans les limbes, le narrateur garde une sensation très nette. Mais, avec le temps, voilà qu’il ne sait plus s’il a rêvé, fantasmé ou vécu cet amour clandestin : «Aujourd’hui, est-ce la mémoire ou la vérité même qui m’empêche d’atteindre ce qui s’est passé entre Yeux Noirs et moi ?». C’est à travers les êtres rencontrés par la suite qu’il va désincarcérer ses souvenirs : Lac, double rêvé, frère de la nuit ; Yvonna, étudiante chinoise dont les grands yeux noirs font enfin exister des années après «un sentiment demeuré orphelin». Autant de souvenirs futurs indispensables pour dépasser sans oublier «ce souvenir perdu». On croyait impossible d’écrire sur l’enfance sans tomber dans la nostalgie simplette et l’écriture guimauve. On avait oublié le génie de Frédéric Boyer.
Parce qu’il a donné rendez-vous, en lui, à l’enfant qu’il a été, le narrateur se bat en duel avec ses souvenirs, ces «prisonniers repentis». Mais le passé est un «aspirateur à matière» – un trou noir -, et la mémoire un «château des erreurs». Comment, dès lors, renouer avec une sensation perdue ? A Nice, dans le jardin d’enfants des sœurs du Saint-Esprit, il frappait trois coups à la porte du dortoir, puis deux. Un code secret qui lui donnait accès à «l’une des chambres les plus secrètes de [s]a mémoire» : deux yeux noirs magnifiques l’attendaient, et de grandes jupes évasées qui frôlaient l’enfant de cinq ans. De la nudité, des caresses de cette jeune fille vite dissoute dans les limbes, le narrateur garde une sensation très nette. Mais, avec le temps, voilà qu’il ne sait plus s’il a rêvé, fantasmé ou vécu cet amour clandestin : «Aujourd’hui, est-ce la mémoire ou la vérité même qui m’empêche d’atteindre ce qui s’est passé entre Yeux Noirs et moi ?». C’est à travers les êtres rencontrés par la suite qu’il va désincarcérer ses souvenirs : Lac, double rêvé, frère de la nuit ; Yvonna, étudiante chinoise dont les grands yeux noirs font enfin exister des années après «un sentiment demeuré orphelin». Autant de souvenirs futurs indispensables pour dépasser sans oublier «ce souvenir perdu». On croyait impossible d’écrire sur l’enfance sans tomber dans la nostalgie simplette et l’écriture guimauve. On avait oublié le génie de Frédéric Boyer.
Juliette Einhorn
► 2 familles criminelles
Les parques de Californie
California Girls, de Simon Liberati, Grasset, 342 p. 20 €.
 Simon Liberati a trois obsessions : les femmes, les destins consumés et l’Amérique des années 60. Parfois, il réussit à les combiner avec brio comme dans Jayne Mansfield 1967, prix Femina 2011, où il faisait revivre au lecteur-voyeur le spectaculaire accident qui coûta la vie à l’actrice américaine de 34 ans sur une route de Louisiane, un soir de juin, la liant pour l’éternité au crépuscule de la broyeuse à rêve hollywoodienne. C’est dans cette optique minutieuse et captivante qu’il aborde, dans California Girls, la fin de l’illusion du Summer of Love grâce à l’un des faits divers les plus marquants du XXe siècle, l’assassinat en août 1969 de Sharon Tate, l’épouse de Roman Polanski enceinte de huit mois, et de quatre autres personnes, dans une résidence des hauteurs de Beverly Hills, à Los Angeles, par quatre membres de la Famille Manson, du nom de ce gourou paranoïaque et musicien raté, qui règne sur une communauté hippie, établie dans un ancien ranch de cinéma, et qui veut déclencher une guerre raciale. Liberati, choqué depuis l’âge de 9 ans par cette tuerie aussi barbare que gratuite, s’est livré à un véritable travail d’enquête. L’auteur d’Eva a tout fouillé, tout lu, les rapports de police, les récits des témoins, les journaux de l’époque, et il offre une version de l’intérieur, glacée, glaçante. Pendant une trentaine d’heures, il suit les errances sexuelles, opiacées et saignantes de Charles «Tex» Watson et de Patricia «Katie» Krenwinkel, Susan «Sadie» Atkins et Linda Kasabian, ces California Girls, ces «gamines de 20 ans» prêtes à tout pour que l’Apocalypse version Manson advienne. Habité par la violence du monde, ce roman, aussi tranchant qu’une lame, offre une caisse de résonance cabossée aux frénésies sanglantes de Daech, secte tout autant dévolue à la folie meurtrière que l’était celle de Charles Manson.
Simon Liberati a trois obsessions : les femmes, les destins consumés et l’Amérique des années 60. Parfois, il réussit à les combiner avec brio comme dans Jayne Mansfield 1967, prix Femina 2011, où il faisait revivre au lecteur-voyeur le spectaculaire accident qui coûta la vie à l’actrice américaine de 34 ans sur une route de Louisiane, un soir de juin, la liant pour l’éternité au crépuscule de la broyeuse à rêve hollywoodienne. C’est dans cette optique minutieuse et captivante qu’il aborde, dans California Girls, la fin de l’illusion du Summer of Love grâce à l’un des faits divers les plus marquants du XXe siècle, l’assassinat en août 1969 de Sharon Tate, l’épouse de Roman Polanski enceinte de huit mois, et de quatre autres personnes, dans une résidence des hauteurs de Beverly Hills, à Los Angeles, par quatre membres de la Famille Manson, du nom de ce gourou paranoïaque et musicien raté, qui règne sur une communauté hippie, établie dans un ancien ranch de cinéma, et qui veut déclencher une guerre raciale. Liberati, choqué depuis l’âge de 9 ans par cette tuerie aussi barbare que gratuite, s’est livré à un véritable travail d’enquête. L’auteur d’Eva a tout fouillé, tout lu, les rapports de police, les récits des témoins, les journaux de l’époque, et il offre une version de l’intérieur, glacée, glaçante. Pendant une trentaine d’heures, il suit les errances sexuelles, opiacées et saignantes de Charles «Tex» Watson et de Patricia «Katie» Krenwinkel, Susan «Sadie» Atkins et Linda Kasabian, ces California Girls, ces «gamines de 20 ans» prêtes à tout pour que l’Apocalypse version Manson advienne. Habité par la violence du monde, ce roman, aussi tranchant qu’une lame, offre une caisse de résonance cabossée aux frénésies sanglantes de Daech, secte tout autant dévolue à la folie meurtrière que l’était celle de Charles Manson.
Myriam Perfeti
Les enfants à table !
Cannibales, de Régis Jauffret, Seuil, 190 p., 17 €.
 Comme certaines bêtes s’acharnant sur les dépouilles, comme d’autres ne quittant pas les territoires de la nuit, certains romanciers hantent les affres de la perversité humaine, passant de crime en crime, de psychose en psychose, d’un mode opératoire à un autre. Après avoir plongé dans les affaires contemporains avec Sévère, Claustria ou encore une tentative de transposition de l’affaire Strauss-Kahn qui valut à l’écrivain il y a quelques semaines une bien injuste condamnation pour diffamation (la Ballade de Rikers Island), Régis Jauffret quitte le fait-divers pour revenir aux territoires de l’imaginaire et à l’écriture de la folie, son domaine privilégié depuis Asiles de fous (2005). Pourquoi celui qui est l’un de nos stylistes les plus élégants et l’un de nos écrivains les plus incontrôlables va-t-il chercher dans les fantasmes cannibales partagés par deux cinglées l’occasion de récrire une version désaxée des Liaisons dangereuses dans ce qui est assurément le récit le plus étincelant et barré de cette rentrée littéraire ? Nul ne le saura sans doute, même s’il faut croire dans les vérités des délires et la poésie du chaos pour comprendre et l’amour et le monde : après tout, comme le suggère Cannibales, «un jour, l’univers retournera comme une bouffée à la lampe magique d’où il est sorti il y a une infinité d’années. On ne saura jamais rien du vœu exaucé qui a eu ces conséquences hurluberlues».
Comme certaines bêtes s’acharnant sur les dépouilles, comme d’autres ne quittant pas les territoires de la nuit, certains romanciers hantent les affres de la perversité humaine, passant de crime en crime, de psychose en psychose, d’un mode opératoire à un autre. Après avoir plongé dans les affaires contemporains avec Sévère, Claustria ou encore une tentative de transposition de l’affaire Strauss-Kahn qui valut à l’écrivain il y a quelques semaines une bien injuste condamnation pour diffamation (la Ballade de Rikers Island), Régis Jauffret quitte le fait-divers pour revenir aux territoires de l’imaginaire et à l’écriture de la folie, son domaine privilégié depuis Asiles de fous (2005). Pourquoi celui qui est l’un de nos stylistes les plus élégants et l’un de nos écrivains les plus incontrôlables va-t-il chercher dans les fantasmes cannibales partagés par deux cinglées l’occasion de récrire une version désaxée des Liaisons dangereuses dans ce qui est assurément le récit le plus étincelant et barré de cette rentrée littéraire ? Nul ne le saura sans doute, même s’il faut croire dans les vérités des délires et la poésie du chaos pour comprendre et l’amour et le monde : après tout, comme le suggère Cannibales, «un jour, l’univers retournera comme une bouffée à la lampe magique d’où il est sorti il y a une infinité d’années. On ne saura jamais rien du vœu exaucé qui a eu ces conséquences hurluberlues».
Alexandre Gefen
►1 premier roman formidable
Deux ou trois choses que je sais de Godard
Sauve qui peut (la révolution), de Thierry Froger, Actes Sud, 435 p., 22 €.
 Le Nantais Thierry Froger, poète et plasticien, est l’inconnu de cette rentrée. Gageons qu’il ne le restera pas très longtemps, tant son premier roman, Sauve qui peut (la révolution) est une pépite au cœur du limon littéraire 2016. Son sujet, comment raconter l’Histoire, est des plus ambitieux. Mais la gageure est tenue, tout au long de ces 435 pages passionnantes, qui voit le cinéaste Jean-Luc Godard, connu pour ne pas raconter d’histoires linéaires dans ses œuvres, se faire confier, en 1988, la réalisation d’un film par la Mission du bicentenaire de la Révolution française. Le voilà donc qui renoue avec un ancien ami de l’époque maoïste, l’historien Jacques Pierre, tombe amoureux de la fille de 20 ans de ce dernier, Rose, et se fourvoie dans les méandres de la Loire. S’entremêlent alors trois récits, celui de l’élaboration de «Quatre-vingt-treize et demi», le scénario alternatif et laborieux de JLG, avec ses notes tapuscrites et manuscrites, celui de la vie alternative de Danton, qui n’aurait pas péri sur l’échafaud en 1794, et que peine à écrire l’historien, et celui de la relation avortée à la jeunesse. Ne reste plus aux protagonistes vieillissants de ce roman virtuose et plein de surprises, à défaut de bousculer le monde, qu’à tenter de raconter ses agitations en rêvant de l’«égalité du réel et de la fiction», confortablement installés dans le «canapé révolutionnaire du verbe». Au carrefour du burlesque et du politique, le Sauve qui peut (la révolution) de Thierry Froger, qui pastiche le titre de l’un des films les plus emblématiques de l’enfant terrible de la nouvelle vague dans les années 80, Sauve qui peut (la vie), interroge de façon jubilatoire, avec ses à-coups poétiques, comme dans un long travelling déroutant et métaphysique, le naufrage de l’âge et celui des illusions. Brillant.
Le Nantais Thierry Froger, poète et plasticien, est l’inconnu de cette rentrée. Gageons qu’il ne le restera pas très longtemps, tant son premier roman, Sauve qui peut (la révolution) est une pépite au cœur du limon littéraire 2016. Son sujet, comment raconter l’Histoire, est des plus ambitieux. Mais la gageure est tenue, tout au long de ces 435 pages passionnantes, qui voit le cinéaste Jean-Luc Godard, connu pour ne pas raconter d’histoires linéaires dans ses œuvres, se faire confier, en 1988, la réalisation d’un film par la Mission du bicentenaire de la Révolution française. Le voilà donc qui renoue avec un ancien ami de l’époque maoïste, l’historien Jacques Pierre, tombe amoureux de la fille de 20 ans de ce dernier, Rose, et se fourvoie dans les méandres de la Loire. S’entremêlent alors trois récits, celui de l’élaboration de «Quatre-vingt-treize et demi», le scénario alternatif et laborieux de JLG, avec ses notes tapuscrites et manuscrites, celui de la vie alternative de Danton, qui n’aurait pas péri sur l’échafaud en 1794, et que peine à écrire l’historien, et celui de la relation avortée à la jeunesse. Ne reste plus aux protagonistes vieillissants de ce roman virtuose et plein de surprises, à défaut de bousculer le monde, qu’à tenter de raconter ses agitations en rêvant de l’«égalité du réel et de la fiction», confortablement installés dans le «canapé révolutionnaire du verbe». Au carrefour du burlesque et du politique, le Sauve qui peut (la révolution) de Thierry Froger, qui pastiche le titre de l’un des films les plus emblématiques de l’enfant terrible de la nouvelle vague dans les années 80, Sauve qui peut (la vie), interroge de façon jubilatoire, avec ses à-coups poétiques, comme dans un long travelling déroutant et métaphysique, le naufrage de l’âge et celui des illusions. Brillant.
Myriam Perfetti
![]() Retrouvez Marianne sur notre appli et sur les réseaux sociaux,
Retrouvez Marianne sur notre appli et sur les réseaux sociaux,
ou abonnez-vous :
|
|
||
Powered by WPeMatico








This Post Has 0 Comments